La rage Outremer
Il y a des souvenirs de vacances qui sont comme le civet de lapin : plus c’est réchauffé, meilleur c’est. Je vous emmène à la mer ?
Aux Antilles on appelle « habitation » la belle demeure des planteurs, avec ses cultures coloniales, sa distillerie, ses moulins, fours à manioc et parking à touristes. Aujourd’hui on se promène parmi les hévéas magnifiques, les figuiers géants aux écorces basaltiques, les mâts altiers des palmiers royaux. Des esclaves, il ne reste rien que quelques dortoirs de pierre, les rues « case nègres ». Certaines réaménagées en bungalows climatisés bordés d’hibiscus. Imaginez un jour, les étés chauds de Pologne, le défilé des paréos à Auschwitz ou Buchenwald : à quand les strings rayés, noir et blanc, en vente à la caisse ? Ça vous choque, ce qui ne choque personne en Outremer ? Cherchez pourquoi, bon exercice.
Parmi les dépendances de « l’habitation » figuraient, tout en bas de l’échelle des avoirs, ces hommes possédés par d’autres qu’on appelle les esclaves. Pour la seule France, un rapport de la Constituante fait encore état de trois millions d’esclaves : encore est-ce la frange résistante qui a survécu au voyage, au travail, à la cruauté. Pour la gloire du commerce triangulaire, la fortune des armateurs, le sucre des tables royales. Ils ont obéi à ces blancs dont les premiers arrivés ne sont que bagnards et putes, cadets de famille et fiancés de la déveine.
Le gardien nous fait passer la main dans cette plante drue au sol qui a le vert des algues et se rétracte à la chaleur : qu’il approche le bout allumé d’une cigarette, elle se renfrogne et se terre. La seule approche d’un doigt suffit à l’émouvoir mieux que ne le ferait le cœur des hommes.
Le gardien est un Indien. Les Indiens sont venus après l’abolition remplacer les esclaves. Chassés par les famines du Bengale, venus des villages de Karnattakam. Beaucoup ont donné aux comptoirs français de Pondichéry et Calcutta, travaillé les laques de Chine sur la côte de Coromandel et servi les englishmen de l’empire. Les autres ont échoué aux Antilles. Ils ont ainsi pris la place dont les Noirs ne voulaient pas. L’Indien, ici, est appelé kouli. Kouli mangeur de chien, kouli balayeur, kouli au poil plus fendant que coutelas, les injures fleurissent dès la cour d’école. On retourne sur eux le mépris qu’on a reçu : on est leur Blanc.
Je lui demande ce que ça lui fait de travailler là où ont souffert les esclaves, s’il pense à tous ces gens, parfois. L’Indien marque un temps, me fait répéter. Puis il fronce les sourcils avant de laisser tomber, avec une moue :
- Les esclaves ? Moi, je ne les ai pas connus, ces gens-là.

La rage outremer
« Comme un tableau »

« Longtemps ...»



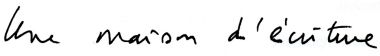
Catherine Vigourt